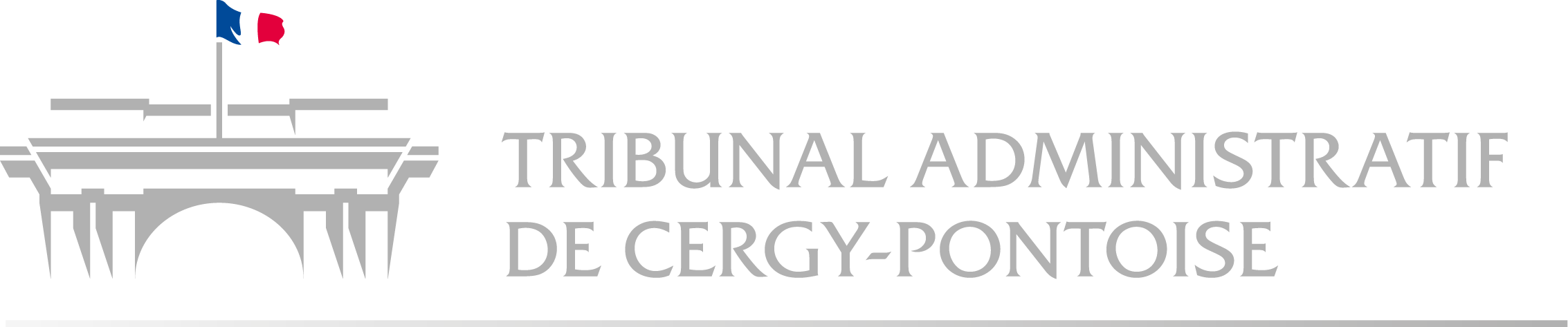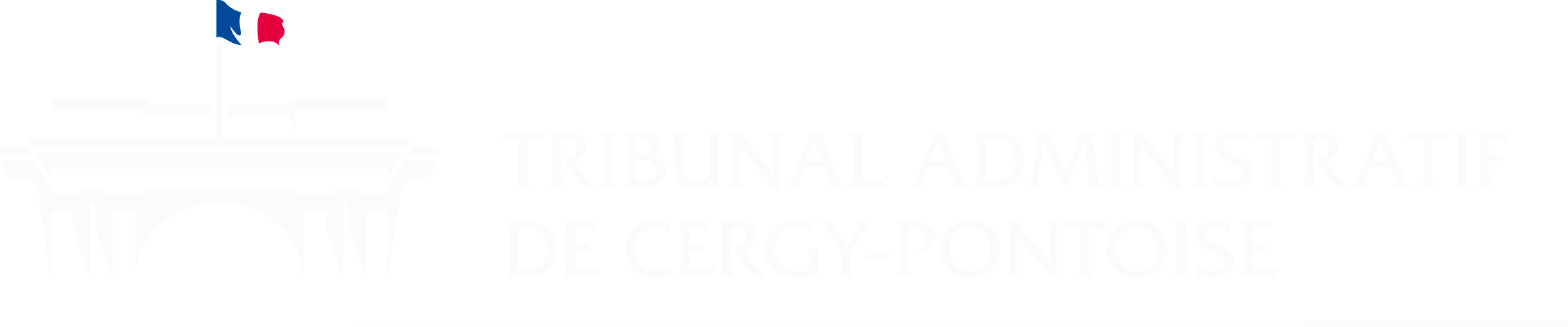Le 24 mars 2025, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, le tribunal a organisé une conférence-débat sur le thème « femmes de justice, de l’autre côté de la barre », organisée en collaboration avec le barreau du Val-d’Oise.
Le 24 mars 2025, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, le tribunal, à l’initiative de sa référente égalité-diversité, Mme Maïna Louazel, et de ses référentes communication, Christelle Oriol et Claire Chabrol, a organisé une conférence-débat sur le thème « femmes de justice, de l’autre côté de la barre », organisée en collaboration avec le barreau du Val-d’Oise. Cette conférence s’est faite sous les regards croisés de Mme Ménès-Redorat, maître de conférence en histoire du droit à CY Cergy Paris Université, Mme Laly-Chevalier, conseillère juridique du représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) en France, Mme Djuinteh, ressortissante camerounaise bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme Solaire, directrice du pôle hébergement en diffus de l’association Espérer 95, Me Parastatis, avocate au barreau du Val-d’Oise spécialisée dans le droit des étrangers, et Mme Louazel, rapporteure publique près la 4ème chambre du tribunal et référente égalité-diversité.
Mme Ménès-Redorat a dressé un panorama de l’histoire des migrations et des réfugiés depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, en insistant sur les causes des migrations des femmes à travers les siècles, notamment pour fuir la guerre et les violences.

Mme Laly-Chevalier, après avoir rappelé les inquiétudes pesant sur les missions de terrain du HCR à la suite du gel des crédits américains, qui représentent 40 % de son budget, a présenté son action en faveur des femmes et filles déplacées de force et apatrides. Les chiffres du HCR sont édifiants : sur 122,6 millions de personnes déplacées dans le monde fin juin 2024, 60 millions étaient des femmes et filles en quête de sécurité. De nos jours, 612 millions de femmes et de filles vivent à moins de 50 kilomètres d’une zone de conflit armé, soit 41 % de plus qu’en 2015.
Le témoignage de Mme Djuinteh, qui bénéficie de la protection subsidiaire, n’en a été que plus éclairant. Après un long parcours, qui l’a conduite du Cameroun en France après un passage par la Belgique, elle a reconnu devoir son statut à l’énergie et l’enthousiasme de ses avocates « extraordinaires » qui lui ont ouvert les portes d’une vie nouvelle.
Souvent, les parcours des femmes arrivant en France se font dans la douleur. Mme Solaire, de l’association Espérer 95, a ainsi indiqué que malgré les efforts du 115 et de l’association, il n’est pas rare que des familles, voire des femmes seules ou avec enfants, se retrouvent à la rue, dans l’attente d’un logement de fortune, sans perspectives d’insertion à défaut de séjour régulier.

C’est là que le témoignage de Me Parastatis, qui a évoqué les cas personnels poignants qui lui sont exposés, a illustré le rôle primordial des avocats pour aider ces femmes, en quête d’écoute et d’humanité, dans leur accès au droit.
Enfin, Mme Louazel a fait part de son expérience de juge administratif lorsqu’elle était affectée en chambre « visas » au tribunal administratif de Nantes, en insistant sur la difficulté qu’il y a parfois à concilier la règle de droit et les situations humaines les plus désespérées.
Pour conclure, le président du tribunal, M. Beaufaÿs, a remercié les intervenantes pour la qualité de leurs analyses, variées, pertinentes et teintées d’émotion. En retenant qu’à l’instar des récentes jurisprudences européennes et nationales définissant l’existence d’un « groupe social des femmes en Afghanistan », le droit reste un instrument essentiel et innovant dans l’élaboration de réponses aux problématiques de genre, y compris ses formes les plus discriminantes.
La conférence a donné lieu à des échanges avec un public venu nombreux, au premier rang duquel, outre le président, la première vice-présidente et la greffière en chef du tribunal, des représentants du barreau du Val-d’Oise et des étudiants de la faculté de droit de Cergy nous ont fait l’honneur de leur présence.
Contacts presse :
Christelle Oriol, Claire Chabrol : communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr